|
L'accident de
Tchernobyl |
mai 2001 | |
| Groupe de Réflexion
Énergie Environnement au 21ème siècle |
||
Le rapport de l'UNSCEAR ne mentionne que des études concernant les affections tératogènes faites à Berlin, en Ecosse et dans les régions les plus contaminées de Suède. Toutes ces études, fondées sur un petit nombre de cas, ont été contestées par la suite. Les doses à Berlin et en Ecosse n'ont atteint que 10% du rayonnement naturel et aucun pic de trisomie 21 n'a été observé dans d'autres pays plus fortement contaminés (Biélorussie, Finlande). Selon d'autres auteurs, la mortalité périnatale en Allemagne aurait augmenté significativement en 1987 ce qui a été attribué à l'accident de Tchernobyl. Ces résultats ont été remis en question lorsqu'on s'est aperçu que les doses d'irradiations dues au césium incorporé n'étaient que de 0.05 mSv. Aucune corrélation avec la dose d'irradiation n'a pu être observée en Bavière. L'IPSN dans ses dossiers de presse fait état d'un article de la revue Nature en 1996 qui impute à Tchernobyl une augmentation du taux de leucémies en Grèce chez les enfants de moins d'un an à l'époque de l'accident, phénomène que le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) n'a retrouvé dans aucun autre pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. Les experts de l'UNSCEAR ont focalisé leurs études sur les pays européens ayant eu des territoires assez étendus contaminés au delà de 37 kBq/m2 (1 Ci/km2), comme indiqué au tableau 4 ci dessus, et donc pas sur la France. Examinons cependant la situation dans notre pays. 4.2. La contamination du territoire national 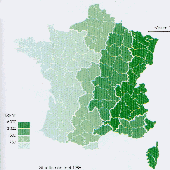 De
très nombreuses mesures ont été effectuées par l'OPRI, l'IPSN,
la CRIIRAD et sans doute d'autres laboratoires. La carte
départementale (fig 11) établie par l'IPSN confirme que la
contamination en césium 137 diminue globalement lorsqu'on se
déplace d'est en ouest. Les hétérogénéités locales sont plus
accentuées : la nature du terrain (boisé ou découvert),
l'altitude, le ruissellement mais surtout la pluie déterminent
l'intensité de la contamination : De
très nombreuses mesures ont été effectuées par l'OPRI, l'IPSN,
la CRIIRAD et sans doute d'autres laboratoires. La carte
départementale (fig 11) établie par l'IPSN confirme que la
contamination en césium 137 diminue globalement lorsqu'on se
déplace d'est en ouest. Les hétérogénéités locales sont plus
accentuées : la nature du terrain (boisé ou découvert),
l'altitude, le ruissellement mais surtout la pluie déterminent
l'intensité de la contamination :
Activités des productions agricoles et produits naturels L'herbe et les légumes feuilles ont été les végétaux les plus touchés. Les transferts de radioactivité au lait sont intervenus en quelques heures et l'activité en iode 131 a pu atteindre localement 1000 Bq/l les premiers jours. L'activité du lait des brebis a été 2 à 3 fois supérieure du fait de leur alimentation. L'activité en césium de la viande a mis 3 à 6 mois pour redescendre à 10 Bq/kg, sauf celle de certains sangliers (2 000 Bq/kg mesurés dans les Vosges). Les champignons qui ont un vaste réseau souterrain à faible profondeur concentrent les minéraux et le césium. Leur contamination peut varier de 15 à 50 000 Bq/kg. 4.3. Les doses reçues par la population française "La dose moyenne reçue par les populations françaises estimée pour 1986 est comprise entre moins de 0.025 mSv dans l'ouest et 0.4 mSv dans l'est. En 1997, la dose annuelle est de l'ordre de 0.001 à 0.015 mSv, ce qui est 100 à 1000 fois inférieur aux doses dues à la radioactivité naturelle. Cette dose moyenne devrait encore diminuer. Dans la moitié est de la France, les doses équivalentes à la thyroïde en 1986 ont pu également être évaluées entre 0.4 et 2 mSv en moyenne pour les adultes, et de 3 à 16 mSv en moyenne pour des enfants de 5 ans. Pour certains cas particuliers d'exposition, les doses calculées atteignent des valeurs de 1.5 mSv en 1986 et 1 en 1987 : elles correspondent à l'hypothèse extrême d'une présence prolongée à l'air libre sur des zones contaminées et d'une consommation quasi exclusive des aliments les plus contaminés aux époques considérées (produits laitiers en 1986, produits forestiers en 1987). L'accroissement d'irradiation globale résultant des retombées de Tchernobyl est donc très inférieur aux variations sur notre territoire de la radioactivité naturelle (sans parler de celle, bien supérieure due au radon dans certaines habitations). Les mesures de concentration en césium 137 de l'atmosphère, faites à Orsay depuis 50 ans, montrent par ailleurs que la part due à Tchernobyl ne représente qu'environ 2% de celle due aux essais nucléaires aériens des années de guerre froide. 4.4. Les effets sanitaires en france Toute concentration dans un organe d'éléments radioactifs pouvant être néanmoins suspectée, la question d'une possible induction de cancers de la thyroïde en France due à l'iode-131 (les autres isotopes à vie courte ayant pratiquement disparu quand le nuage est arrivé sur la France) a été posée malgré la faiblesse des doses, cent fois moindre que celle des enfants de Bélarus. Il a été fait état, par l'IPSN, d'une augmentation des cancers de la thyroïde chez l'enfant dans la région PACA, pouvant être reliée aux conséquences de l'accident de Tchernobyl. Cette communication, à caractère non scientifique, a été ensuite rectifiée : en effet, le nombre plus élevé de cancers de la thyroïde inscrit dans les registres de la région PACA, après l'accident de Tchernobyl, n'avait qu'une origine technique. Quand on met en place un registre d'incidence des cancers, les premières années montrent des fluctuations liées à l'introduction de cancers diagnostiqués à différentes époques. C'est ce surenregistrement qui a été constaté. L'interprétation d'une augmentation vraie de l'incidence était donc erronée et a été rectifiée par les services compétents du ministère de la Santé. Les registres d'incidence des cancers de l'enfant établis plusieurs années avant l'accident de Tchernobyl ne mettent pas en évidence de variation imputable à l'accident, comme l'a montré une étude récente concernant la région Champagne Ardennes. En fait, le nombre recensé de cancers de la thyroïde augmente lentement et régulièrement en France, depuis 1975, comme dans les autres pays européens ou aux Etats-Unis (non contaminés par Tchernobyl), mais la mortalité par ce type de cancer ne croît pas. Cette augmentation (dont la "pente" a été d'ailleurs trouvée plus forte dans certaines régions les moins affectées par les retombées de Tchernobyl !) et qui n'est pas propre à la France, traduit l'amélioration des moyens diagnostiques durant les dernières décennies, en particulier l'emploi de l'échographie. Dans un communiqué commun de décembre 2000, l'IPSN et l'InVS, utilisant l'hypothèse d'une relation linéaire dose-effet sans seuil, chiffrent entre 7 et 55 le nombre de cancers de la thyroïde qui pourraient être imputés à l'accident sur la période 1991-2015 (pour 900 cas spontanés attendus). Ce calcul théorique a pour intérêt de donner une valeur maximum de l'effet recherché, mais ne vaut que ce que vaut l'hypothèse de linéarité, très contestée en tant que modèle prédictif (voir annexe). D'autre part, il utilise comme modèle de risque des données provenant d'irradiations externes faites à des débits de dose plus de mille fois supérieurs à ceux résultant de l'iode 131. Comme l'indique par ailleurs l'IPSN, "compte tenu des limites méthodologiques indiquées ci-dessus et des incertitudes sur l'existence d'un risque aux faibles doses, il est aussi possible que l'excès réel de risque de cancer thyroïdien, aux niveaux de dose considérés ici, soit nul." 4.5. Rappel et reflexions sur la communication C'est par le journal télévisé du lundi 28 avril 1986 que chacun prit connaissance en France d'un accident nucléaire survenu sur une installation soviétique. Le matin même, des détecteurs de radioactivité à l'entrée des centrales nucléaires suédoises avaient donné l'alerte : les employés étaient contaminés. Le soir même, l'agence TASS reconnaissait l'existence d'un grave accident et précisait son origine : le réacteur n° 4 de la centrale de Tchernobyl. Le 29 avril, le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) dépendant du Ministère de la Santé faisait procéder à des prélèvements d'air par des avions de ligne survolant le nord de l’Allemagne et communiquait à l'Agence France Presse la composition des gaz radioactifs présents dans les couches atmosphériques traversées. Dès lors, le devenir des masses d'air contaminées, appelées improprement "nuage" de Tchernobyl, allait passionner et inquiéter l'opinion, d'autant que des vents variables d'un jour à l'autre allaient disperser dans différentes directions des émissions qui ne furent maîtrisées qu'au bout de dix jours. La France fut affectée par des produits radioactifs émis le 27 avril, qui parvinrent sur ses frontières du sud-est puis de l'est dans la nuit du 29 au 30, soit quatre jours après l'accident. Ils furent détectés par le réseau national de balises du SCPRI, les stations météo des centres du CEA et des centrales EDF, ainsi que par diverses autres stations (Monaco par exemple). Le 30 avril à minuit, le SCPRI envoya à l'AFP un communiqué indiquant "sur certaines stations du sud-est une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique", ce qui fut rapporté par la presse du 2 mai. Il régnait alors en Europe et sur la France un régime instable de courants atmosphériques et les particules radioactives lessivées par des pluies locales se déposèrent en formant des taches radioactives irrégulières dont l'intensité locale ne put être constatée qu'ultérieurement. Toutefois l'action du temps et de la distance avait permis de diluer les matières en suspension. L'intensité des retombées était bien moindre que dans d'autres pays européens et d'un facteur 100 à 1000 fois plus faible que celle affectant certaines régions de l'URSS. C'est le SCPRI qui, conformément à sa mission, effectua l'essentiel des mesures de radioactivité sur notre territoire (plus de 5000 du 30 avril au 31 mai), en évalua les conséquences sanitaires et assura la communication correspondante (un communiqué quotidien aux autorités et aux principales agences de presse), le CEA se chargeant de l'information sur l'accident lui-même et tentant, à l'aide de codes de diffusion atmosphérique, d'estimer l'importance probable des retombées sur notre sol. Des cellules d'information téléphonique furent ouvertes au public au SCPRI (24 heures sur 24) et au Siège du CEA. Le chef du SCPRI et le directeur de l'IPSN furent sollicités sur les ondes et à la télévision. Suite à l'émotion suscitée par l'accident, le ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille, Mme Barzach, fit paraître le 16 mai deux communiqués : "La Santé n'est aucunement menacée par les conséquences de cet accident. Les activités courantes peuvent donc être poursuivies sans précautions particulières, notamment :
"le déroulement des grossesses en cours ne nécessite aujourd'hui, à ce titre, absolument aucune précaution particulière"
Dans son rapport annuel pour 1986, l' IPSN écrit de son côté : "La pression médiatique a été très importante et, en accord avec la Direction du CEA, la Direction de l'IPSN a joué dès le début la carte de la transparence et de la disponibilité maximales, pour les sujets ressortissant de sa responsabilité. Les principales actions de communication ont revêtu la forme d'émissions télévisées sur les chaînes françaises et sur des chaînes locales et étrangères ; de conférences de presse par le Directeur de l'Institut ; de contacts téléphoniques ou directs avec des journalistes de toute la presse française et étrangère ; d'exposés audiovisuels au profit des ministères, de comités officiels, de sociétés savantes, d'EDF et Framatome, etc. ; de réponses à des questions du milieu médical ou de particuliers ; de l'élaboration et de la diffusion aux agences de presse et à la presse, de documents techniques dont le "rapport Tchernobyl" etc. Ces bilans quantitatifs sur la communication, à première vue satisfaisants, tranchent avec l'image désastreuse qu'en ont donné les médias, mettant en question sa forme et/ou son contenu, ce qui montre sans doute qu'elle n'était pas adaptée à son temps. Les intervenants n'ont pas réussi à faire partager leurs convictions affichées sur le faible danger encouru par la population française. On peut invoquer plusieurs causes objectives :
Mais il faut reconnaître aussi qu'il avait fallu improviser rapidement l'organisation de la communication officielle et que celle-ci fut jugée trop centralisée. Les déclarations, plus qualitatives que quantitativement étayées, selon lesquelles les retombées en France ne présentaient aucun danger sanitaire heurtèrent les tenants de l'hypothèse de linéarité des effets aux doses sans seuil, qui considèrent que tout surcroît d'irradiation, même très faible, est nuisible à la santé. Divers laboratoires universitaires effectuèrent de leur propre initiative des mesures de radioactivité dans l'environnement et publièrent leurs résultats bruts assortis de leurs commentaires. Ces actions furent à l'origine d'associations diverses, telles la CRII-RAD, qui participent aujourd'hui à certaines campagnes de mesures. Hors de l'URSS, les pays européens exposés à la contamination radioactive prirent des mesures restrictives pour la consommation des produits alimentaires et les experts de la Communauté Européenne durent se réunir à plusieurs reprises (les 6, 16, 25 et 30 mai) pour définir des seuils d'activité massique acceptable pour les denrées alimentaires importées des pays tiers (le 6 mai, une valeur limite de 500 Bq/l en I-131 fut adoptée pour le lait, seuil, on le voit, beaucoup plus contraignant que celui admis en 1957 lors de l'accident de Windscale). L'Allemagne en particulier, assez touchée dans certaines régions (Bavière notamment) prit sur l'ensemble de son territoire des mesures que le gouvernement français n'adopta pas. Une phrase dont l'origine mériterait d'être élucidée fut rapportée selon laquelle "le nuage n'avait pas traversé la frontière". Les critiques les plus récentes adressées au Professeur Pellerin, chef du SCPRI de l'époque, le conduisirent à porter par deux fois plainte pour diffamation, une première fois contre les auteurs d'un livre (le tribunal se déclara incompétent mais reconnut la diffamation), la seconde contre un député et une chaîne de télévision (procès du 11/10/2000, gagné en première instance). Comment le SCPRI aurait-il pu annoncer au soir du 30 avril une "légère hausse de la radioactivité atmosphérique" si les particules du fameux "nuage" n'étaient pas arrivées ? Lors d'un accident inattendu et très médiatisé comme celui-ci, deux écueils doivent être évités : prendre des mesures de précaution excessives susceptibles de provoquer des paniques injustifiées et d'entraîner des conséquences fâcheuses (l'un des risques est ici d'inciter indirectement à des interruptions volontaires de grossesse totalement infondées), et inversement tenir des propos trop rassurants laissant croire que l'on traite à la légère les questions de santé publique et que l'on cache l'ampleur des risques. Le "principe de précaution" tant invoqué de nos jours ne doit pourtant pas inciter les décideurs à se défausser d'un risque très minime où leur responsabilité pourrait être recherchée, en faisant courir en contrepartie des risques très supérieurs, mais les engageant moins personnellement. Dans son éditorial du bulletin de l'OPRI de décembre 2000, le Professeur Lacronique écrit : "En tant que Président de l'organisme qui a succédé au SCPRI, il m'arrive souvent de devoir répondre à la question suivante: "Que feriez vous aujourd'hui si vous étiez confronté à un accident identique ?". Ma réponse est invariable: "Je ferais sans doute le même diagnostic sanitaire pour la France que mon prédécesseur en 1986. Mais comme nous sommes en l'an 2000 et que les attitudes ont changé depuis cette époque, je ferais ce qu'il ferait sans doute lui-même aujourd'hui à ma place, en multipliant les mesures de précaution, et surtout en faisant jouer les mécanismes de décision collective du réseau de sécurité du nucléaire français." Nombre de grands médecins, constatant le nombre de morts imputables au tabac rien qu'en France depuis l'accident de Tchernobyl (près d'un million) et le peu d'écho de leurs mises en garde sur ce danger, s'étonnent des réactions que suscite la crainte d'un seul décès éventuel par cancer de la thyroïde (risque qu'ils réfutent). Mais sans doute la comparaison entre les risques librement consentis par les individus (certaines attitudes sont quasi suicidaires, ou involontairement meurtrières) et leurs exigences en matière de sécurité publique relève-t-elle plutôt du sociologue que du médecin. Ils s'interrogent également sur leurs responsabilités en matière d'information et les moyens d'améliorer cette dernière La création en janvier 2001 d'une Fédération des Enseignants de Radiobiologie, Radiothérapie et Radioprotection (FE3R) veut répondre à cette préoccupation. |